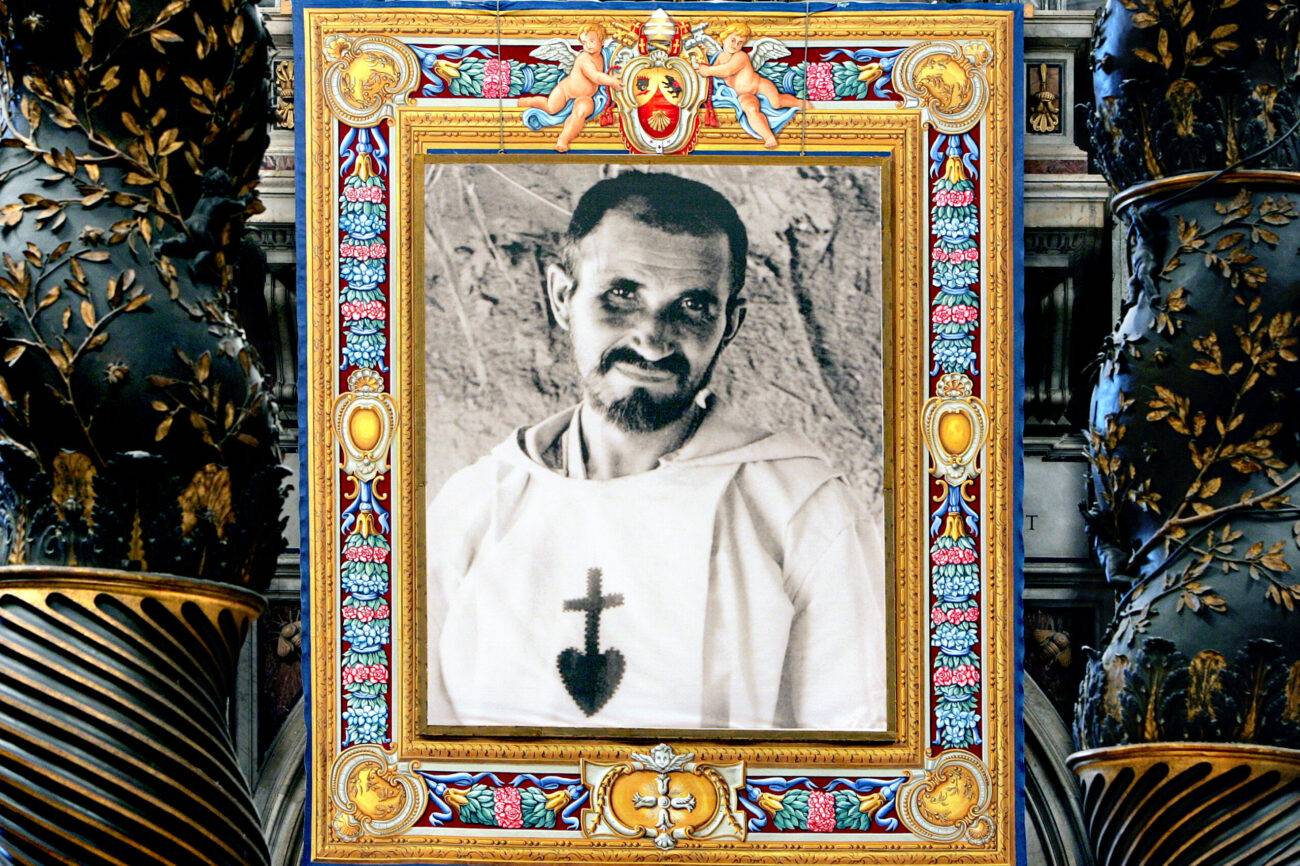Wuhan (8,5 millions d’habitants) fait partie de la province de Hubei, au centre de la Chine. Jean-Gabriel Perboyre a été d’abord envoyé dans la province de Henan (qui touche la province de Hubei). Arrivé aprés un difficile voyage sur son lieu de mission en aout 1836, il y trouve une population misérable de quelques 2000 chrétiens répartis sur de grands territoires. Pour aller à leur rencontre il parcourt des centaines de kms à pied. Il y restera deux ans pour répondre en 1838 à une autre mission dans la province de Houpé. Il sera condamné à mort le 15 juillet 1840 par le tribunal de la province de Hubei à Ou-Tchang-Fou (Wuchang, quartier de la ville de Wuhan). Devinant la sanction future, c’est là qu’il confie à un catéchiste venu le visiter: « Je suis heureux de mourir pour le Christ ».