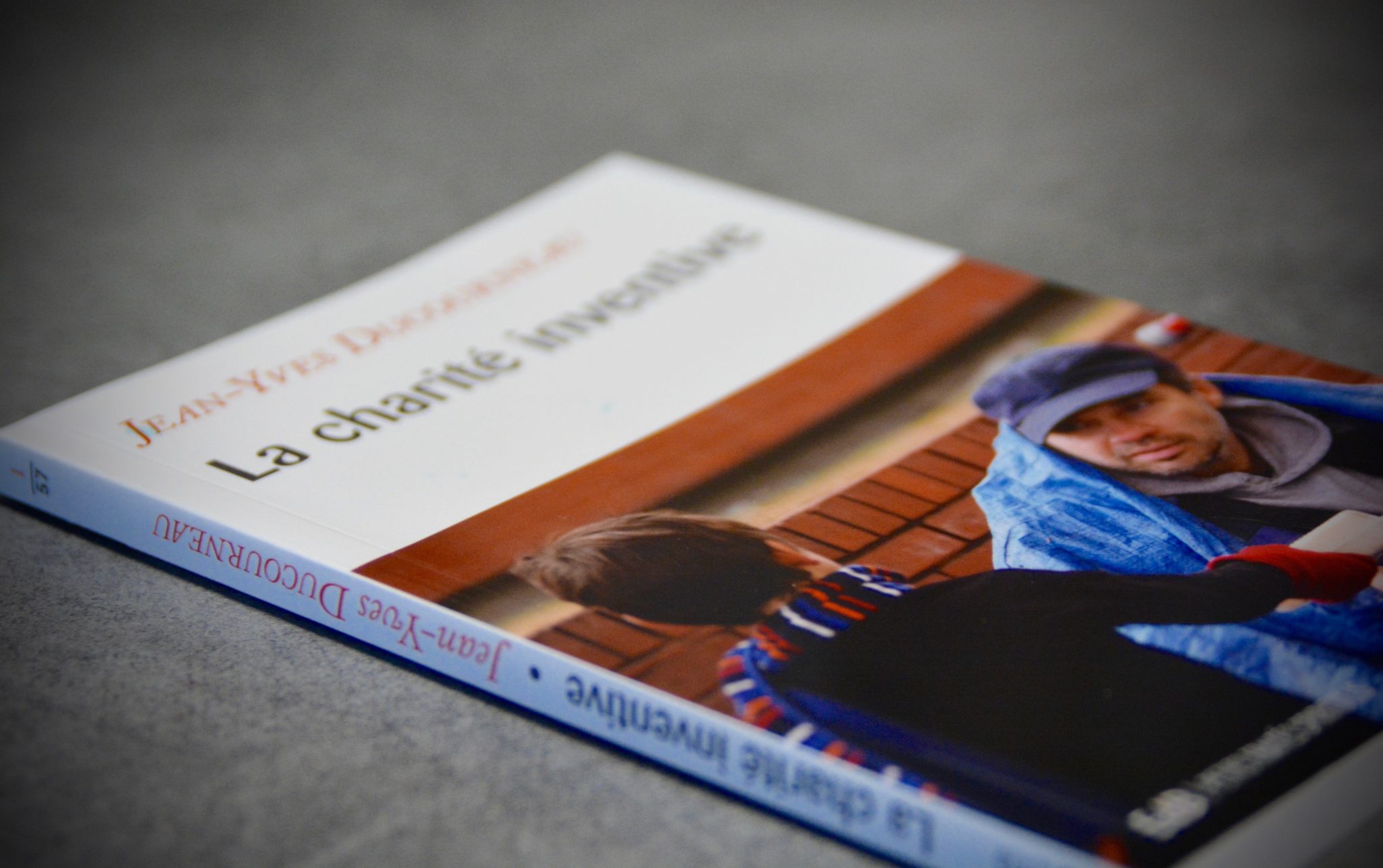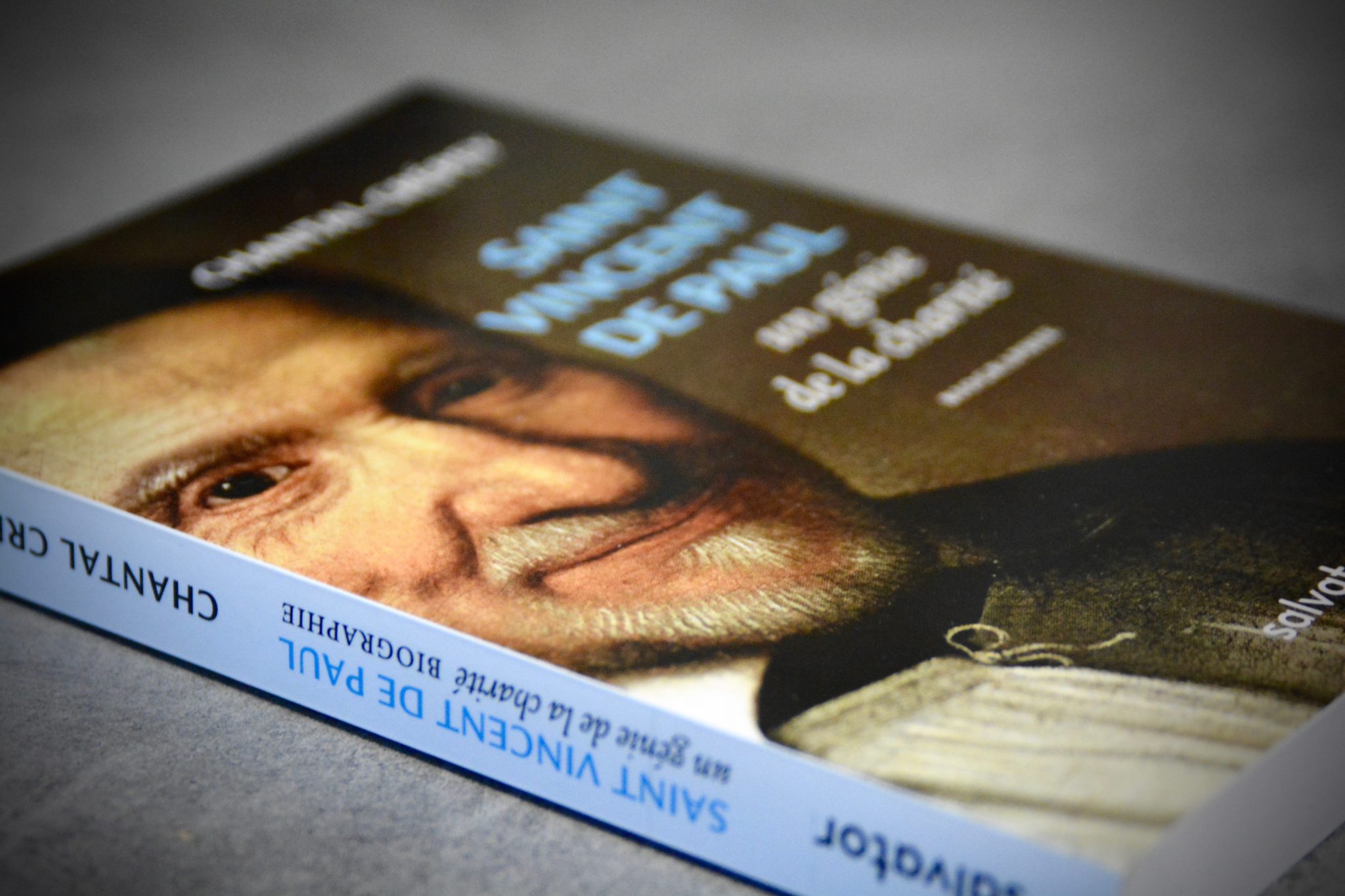Homélie 400e anniversaire de la Mission Paroissiale de Villepreux. 24 janvier 2018
Nous sommes au début du cinquième centenaire du Charisme vincentien. Il nous offre une occasion unique de réfléchir, de décider et d’agir. Il nous donne l’occasion de continuer nos efforts pour faire de la Famille vincentienne ce que Dieu veut qu’elle soit.