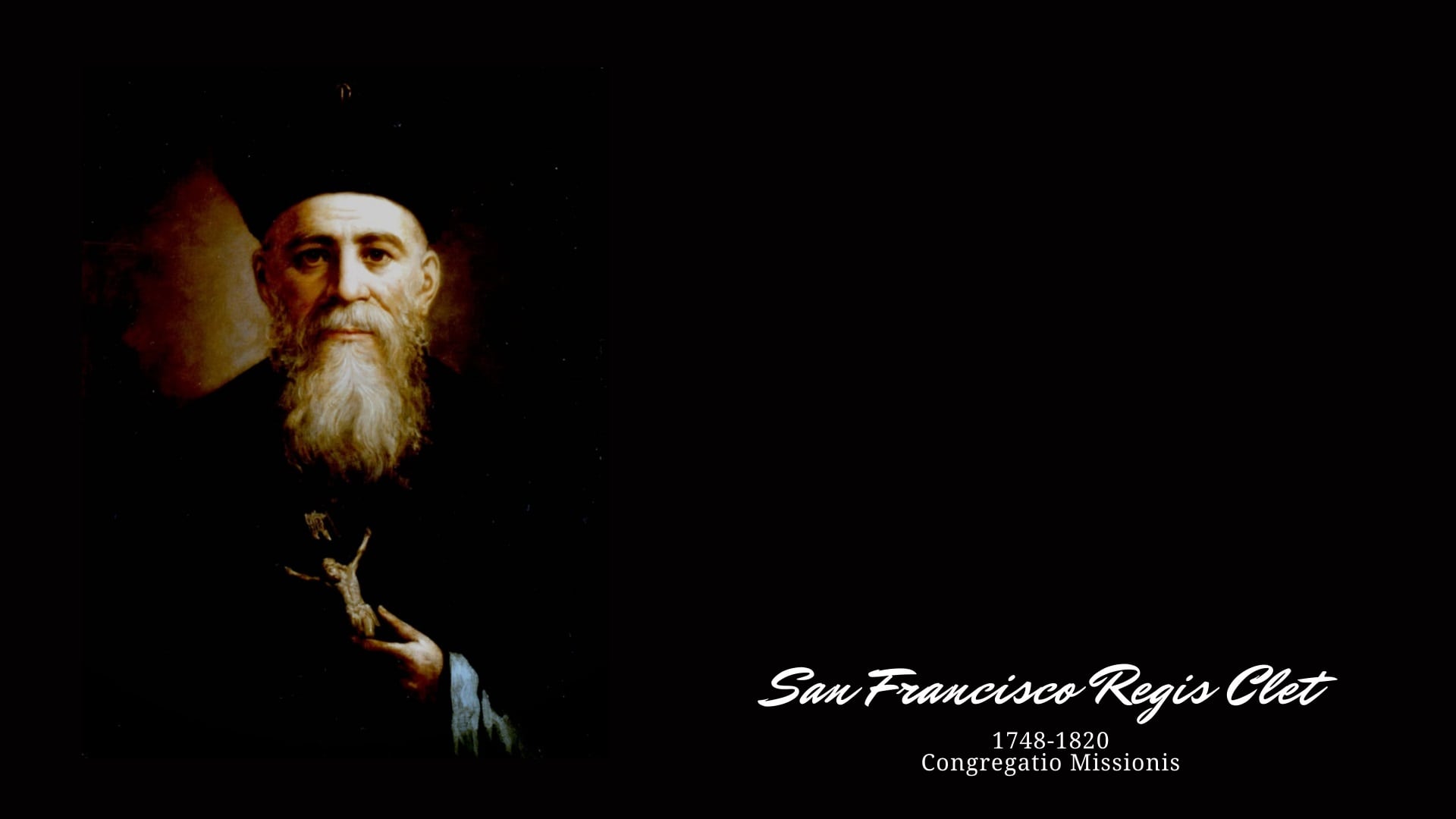La Joie de la Mission n’ayant pas de frontières, le missionnaire, sans nier l’importance de la paroisse et du diocèse dont il sait que ces structures existent tout autour de la terre, a pour terrain apostolique le monde, à la suite de l’envoi direct fait par Jésus lui-même : « Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20).